La pureté rituelle est un pré-requis dans les paganismes indo-européens. C’est un concept qui a pris beaucoup d’importance en Inde et en Perse, comme on peut le voir aujourd’hui dans l’hindouïsme et le zoroastrisme. En Europe, les procédures semblent avoir plus été simples et moins strictes. Il n’empêche pas moins que, pour les traditions européennes dont nous avons des traces écrites de la liturgie, il est indispensable, pour accomplir un rite de manière valable, de se laver au moins les mains à l’eau claire. C’est d’ailleurs pour cette raison que l’Eglise orthodoxe et l’Eglise catholique romaine accordent une si grande importance à l’eau bénite : il s’agit d’un héritage païen qui continue à irriguer notre société par-delà les siècles, avec une telle force que la nouvelle foi elle-même a dû s’y conformer (les protestants évangéliques ne s’y trompent pas, la plupart rejetant ce « rite païen »).

Bénitier à l’entrée de la basilique de Fourvières, à Lugdunum. Certaines choses ne changent pas !
Aujourd’hui, dans un monde entré dans l’Âge de Fer et qui nie toute dimension sacrée au Cosmos, se purifier avant un rite est d’autant plus important. Les souillure, ou miasmata pour reprendre le terme grec, sont absolument partout : dans la publicité omniprésente qui pollue notre inconscient (y compris par le biais des réseaux sociaux), dans les dégâts infligés à la Terre nourricière par le mode de vie occidental à chaque fois que nous nous déplaçons, utilisons un appareil électrique, mangeons un produit de l’industrie agro-alimentaire… Se purifier, c’est le meilleur moyen de nous reconnecter à la source première de notre tradition, pour rejoindre nos Ancêtres de l’Âge d’Or dans leur proximité avec les Dieux. Ceci s’applique à tout païen de tradition européenne, qu’elle soit celtique, slave, germano-scandinave, etc. La grande question est de savoir comment s’y prendre, puisque nous ne connaissons pas toujours avec précision les gestes et les mots des anciens.

L’arbre Yggdrasill, manuscrit AM 738 4to (Islande, env. 1680)
Le plus important est clairement de se laver les mains, comme le soulignent toutes les sources grecques et romaines (des descriptions de l’Iliade aux fragments des Purifications d’Empédocle : c’est une coutume nommée khernips en grec ancien). Le mieux est de le faire « à l’eau claire », c’est-à-dire en versant l’eau sur l’une puis l’autre main, sans les plonger dans le récipient pour le ne pas en souiller le contenu (en intérieur, une bassine placée sous les mains sert à recueillir l’eau pour la remettre à la terre : ne la laissez pas s’écouler dans les canalisations). On peut ensuite aussi s’asperger le front également, en versant d’abord de l’eau dans une main.
L’eau devrait être de l’eau de source, si possible puisée directement à une source de votre terroir et stockée à côté de votre autel (ce qui vaudra mieux que de l’eau en bouteille plastique vendue par des multinationales). Certains y ajoutent du sel, élément purificateur ; ou, comme les Grecs, y éteignent un morceau de bois enflammé, geste qui a aussi l’avantage de rappeler la cosmogonie druidique (« Ces druides, et d’autres comme eux, professsent que […] un jour pourtant régneront seuls le feu et l’eau », Strabon, Géographie, IV, IV, 4, trad. Cougny) et scandinave (le grand arbre Yggdrasill, au pied duquel coulent trois sources, relie les neuf mondes qui composent l’Univers, lui-même né de la rencontre entre la glace de Niflheim et le feu de Muspelheim).
On peut imaginer se laver les mains sans paroles, mais on sait qu’il était important pour les anciens d’utiliser des formules consacrées pour chaque geste rituel. D’une part parce que notre religion est ce qui relie les hommes aux dieux et les hommes entre eux, et que les hommes communiquent par la parole. D’autre part parce que l’usage de formules antiques nous permet de nous connecter avec nos Ancêtres, qui sont nos guides pour renouer avec les Dieux en notre période troublée. Et, pour finir, il ne faut pas oublier que, lorsque nous parlons en français ou dans toute autre langue indo-européenne, nous utilisons la langue des *Deywós, des dieux célestes et lumineux. Ce n’est pas le cas dans les autres familles de langues. En proto-sémitique, la racine *?-L, qui a donné Allah en arabe et Elohim en hébreu, était aussi utilisée pour dire « fort, puissant, seigneur, magistrat ». Le mot chinois pour désigner les dieux, shén, signifie dans d’autres langues apparentées « esprit, âme » en insistant sur le côté invisible et immatériel de la chose. En Afrique, chez les Yorubas, une Divinité est un òrìṣà, c’est-à-dire une « tête choisie » pour être un intermédiaire du dieu suprême Olorun (òrì, qui se traduit par « tête », signifie aussi la conscience et la destinée de chaque personne ; c’est un concept très riche mais impossible à traduire réellement dans une langue et une mentalité européenne).
Chaque famille de langue porte dans sa tradition une conception bien particulière du divin, et, par la parole, nous ancrons notre spiritualité dans un héritage indo-européen qui donne son vrai sens à nos pensées et à nos actes. Nos Divinités ne sont ni des maîtres dont nous sommes les esclaves, ni une infinité d’entités mystérieuses et invisibles qui sont disséminées un peu partout. Ce sont, comme le soleil, à la fois une métaphore des cycles cosmiques, une source de vie et de réconfort, des points de repère pour s’orienter, et une lumière qui nous permet de percevoir le monde qui nous entoure.

Pour en revenir à notre sujet, quelles paroles pouvons-nous donc dire lorsque nous nous lavons les mains à l’eau claire avant un rite ? On peut trouver en Inde une courte prière répondant directement à cet usage, dans l’Atharva Veda. Plus récent de quelques siècles que les hymnes du Rig Veda, l’Atharva Veda est une compilation de formules magiques qui remonterait tout de même à 3000 ou 3500 ans, ce qui reste plus ancien de quelques siècles que les poèmes d’Homère et d’Hésiode, qui sont les plus vieilles sources dont nous disposions en Europe. Puiser dans l’Atharva Veda, c’est donc certes prendre notre inspiration en Inde, mais à une époque où il existe encore peu de différences avec l’Europe, une époque si ancienne que les Baltes et les Slaves, ou les Irlandais et les Gaulois, commencent seulement à peine à parler des langues différentes et pouvaient encore espérer se comprendre. Nous pouvons donc prononcer ces mots en faisant couler l’eau claire sur nos mains :
QUE L’EAU IMMACULÉE LAVE L’IMPURETÉ,
PURGE, ET ACTES MAUVAIS, ET MAUVAISES PENSÉES.
DE VOS YEUX BIENVEILLANTS, EFFACEZ NOS SOUILLURES,
EAUX RUISSELANT SUR NOUS AVEC DE BONS AUGURES !
(Adapté de l’Atharva Veda, XVI, 1.10-13, trad. Ralph T.H. Griffith)
Il est évident, et plusieurs textes grecs abordent le sujet, que cette purification ne nous lave pas des fautes graves (parjure, meurtre, manquement à l’hospitalité en tant qu’hôte ou en tant qu’invité, profanation d’un lieu consacré). De même, il est important, quand on accompagne le bon geste (se laver les mains) par la bonne parole (la formule ci-dessus), d’y joindre aussi la bonne pensée, c’est-à-dire une pensée tournée vers les Divinités, exempte de colère et d’orgueil, mais aussi de crainte superstitieuse et de soucis du quotidien.

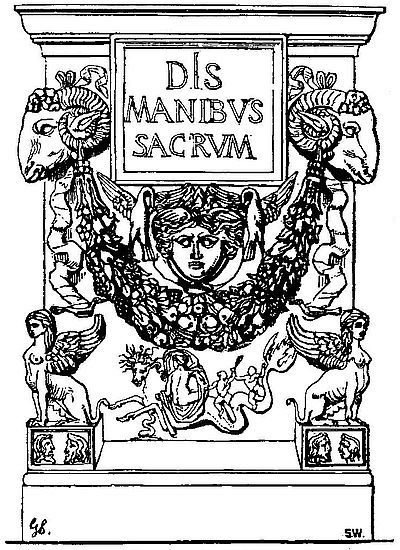






Des os et débats